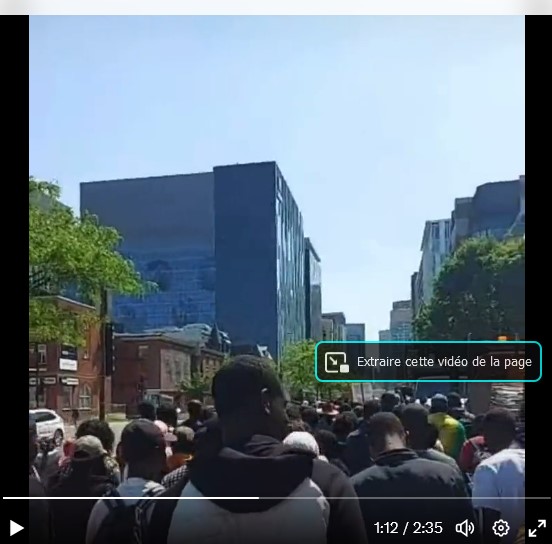Fast backlinks and Guest-post hosting
Les dernières Rencontres Cinématographiques de Dakar (RECIDAK), que l’on organisait tous les ans, ont eu lieu en 2002. Mais en juillet 2013, on a décidé qu’il fallait les ressusciter. L’édition 2014 des Recidak, qui s’est ouverte le 16 décembre, a pris fin ce samedi 20 décembre. A Dakar, Ziguinchor, Sédhiou ou Koungheul, des centres culturels ont accueilli des projections de films, des ateliers de formation sur la réalisation du film d’animation ou sur le scénario. Des expositions sur les pionniers du cinéma de chez nous ou sur les femmes et les jeunes cinéastes sénégalais. Ou encore une rencontre sur la situation et les perspectives du 7ème art sénégalais. Quand on y songe, il ne manque finalement pas grand-chose au cinéma sénégalais. Ni les femmes ni les hommes, ni le talent encore moins l’envie ou la passion. Concevoir, fabriquer, produire ou visionner un film. Ou alors s’autoproclamer « cinéphile », tout simplement, l’aveu d’un passionné de cinéma. Mais il manque tout de même quelque chose au cinéma de chez nous…quelque chose que l’on pourrait résumer à ces quelques mots : harmoniser, faire les choses ensemble ou encore avoir une vision globale.
Hugues Diaz, qui est à la tête de la direction de la Cinématographie depuis 2012, explique que la « théorie du cinéma sénégalais a toujours reposé sur l’Etat ». En d’autres termes, que fait l’Etat ou que doit-il faire ? Le directeur de la Cinématographie estime qu’il est tout aussi impensable d’organiser le cinéma avec les seuls professionnels du secteur : «ce qui équivaudrait à faire du surplace». Ce qui signifie que si on veut développer le 7ème art de chez nous, il faut forcément une approche globale, systémique, inclusive : l’Etat oui, mais pas sans les professionnels.
La responsabilité de l’Etat du Sénégal, comme dit Hugues Diaz, c’est de «créer l’environnement favorable à l’exercice des métiers du cinéma et au déploiement d’industries cinématographiques sur le territoire». Surtout que, dit encore le directeur de la Cinématographie, les producteurs font des efforts pour ce qui est de la production de films. L’Etat les aide ensuite dans tout ce qui est diffusion. En organisant par exemple la sortie du film que ce soit au Théâtre National Daniel Sorano, au Grand Théâtre ou ailleurs. Ou alors, « en intégrant le cinéma dans les festivals privés, comme le Festival de Folklore et de Percussions de Louga » et même celui de la Calebasse à Ziguinchor. Toujours pour aider le cinéma, l’Etat «achète les droits de diffusion de certains films. Il arrive même que ce soit des droits sur une longue période, pour permettre à des écoles de les visionner à des fins éducatives et culturelles».
Le «cinéma des cinéastes »
Autrement dit : avoir une industrie cinématographique. Hugues Diaz pense d’ailleurs que le Sénégal n’en a jamais eue, même si nous avons toujours eu de « très grands cinéastes ». Ne serait-ce que parce que, sous l’ère de quelqu’un comme Ousmane Sembène, «il n’y a jamais eu d’école de formation ».
Journaliste et critique de cinéma, Baba Diop n’en pense pas moins, lui qui dit que « le cinéma sénégalais a toujours été pensé comme celui des cinéastes. Ils faisaient leurs films, dictaient à l’Etat, mais sans prendre en compte l’ensemble de la chaîne». Or, comme il dit, on ne peut pas faire un film en étant tout seul. Il y a la technique, mais pas seulement, et tous «les corps des métiers qui gravitent autour du cinéma doivent être formés». Parce qu’il faudra toujours des distributeurs, des exploitants ; il y a aussi le décor, la musique de films, les costumes aussi. La styliste Oumou Sy par exemple compte parmi ceux qui conçoivent des costumes de films. Ce qui, selon Baba Diop, donne des raisons d’espérer.
L’école du cinéma
Pour ce qui est de la formation toujours, l’Etat, selon le directeur de la Cinématographie, reconnaît que, dans les années passées, il y a eu quelques lacunes. Là encore, il faut « organiser », aller jusqu’à harmoniser les curricula. Parmi les projets de l’Etat, il y a la création d’un Institut Supérieur des Métiers du Cinéma de l’Audiovisuel et du Multimédia. Les responsables ont d’ailleurs « dépêché une mission en Inde, au mois de juin dernier pour (…) produire un document qui présente cet Institut supérieur. » Le document est prêt, dans sa définition conceptuelle, mais « sans l’approche financière ».
En attendant, donc en l’absence d’une école rappelle Baba Diop, « certains ont trouvé des alternatives pour se perfectionner ». Il donne l’exemple de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui offre la possibilité de suivre un Master 2 en réalisation documentaire. Ciné Banlieue aussi forme des jeunes, Cinékap (un studio de production cinématographique et audiovisuelle ouest-africain installé à Dakar) a aussi son projet en tête. Toujours selon Baba Diop, il y a aussi ce qu’on appelle « les pépinières d’entreprise ». « C’est-à-dire, faire en sorte que des jeunes puissent se regrouper, avoir une formation dans le domaine du doublage, mais aussi dans le domaine de la production, pour compléter une chaîne». De quoi être optimiste pense-t-il.
« Organiser »
Mais si dans le domaine du cinéma il n’y a pas de visibilité selon Baba Diop, c’est parce que chacun travaille un peu dans son coin. Il faut « organiser », c’est le mot. Ce qui passe forcément selon lui par « un répertoire des métiers ». Pour qu’on n’ait plus à dire par exemple, qu’au Sénégal il n’y a pas de costumier ou d’ingénieur du son, et «pour qu’on puisse aussi savoir qui fait quoi, et axer notre formation sur ce qui manque». Ensuite, il faut «renforcer les capacités de ceux qui ont commencé par eux-mêmes. Parce que tant qu’on n’aura pas une vision industrielle de notre cinéma, on restera toujours un pays qui certes fait des films, mais qui n’a pas de cinématographie complète ».
Hugues Diaz pense aussi que c’est pour cette raison qu’il faut des conservateurs d’archives, des professionnels de la propriété privée, des syndicalistes, des experts-comptables, des fiscalistes, etc. Pour donner une approche économique au secteur du cinéma, et pour que chaque producteur puisse avoir cet état d’esprit : « je cherche des fonds pour créer un produit que je veux rentabiliser ». L’Etat veut d’ailleurs mettre en œuvre un Centre technique de production, dans les anciens locaux du Service d’hygiène qui ont été mis à la disposition du ministère de la Culture et de la Communication.
Baba Diop, comme Hugues Diaz d’ailleurs, pense que les structures de formation doivent avoir à l’esprit qu’on peut difficilement former des réalisateurs ou des cinéastes qui ne connaissent pas suffisamment leur environnement culturel ou sociologique. Si le 7ème art marche dans des pays comme l’Inde ou le Nigéria, avec respectivement Bollywood et Nollywood, c’est entre autres pour cette raison. Le premier marché, c’est l’intérieur, on conquiert ensuite l’extérieur. C’est la meilleure manière de construire une industrie selon le directeur de la Cinématographie. Sans doute parce que, comme dit Baba Diop, « on est curieux de ce que font les autres, c’est ce qui enrichit la création. (…)C’est cela qui donne un charme, quelque chose de différent ».
« Réguler…fédérer »
Mais au-delà de tout cela, ce qu’il faut c’est un «organe régulateur», un organe qui fédère, comme le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), en France. C’est ce que pense quelqu’un comme Baba Diop. Une institution « qui s’occupe de l’environnement du cinéma, qui a les textes, qui gère l’argent pour le financement des films, avec des comités qui sélectionnent les films etc. » Seulement pour cela, « il faut aussi que les télévisions participent, qu’il y ait un quota, que celles-ci s’engagent à coproduire un certain nombre de films et à les diffuser. Ou alors qu’ils s’engagent à acheter des films, même s’ils n’y participent pas. La publicité doit aussi verser de l’argent. » Le journaliste et critique de cinéma pense aussi que si on veut développer le cinéma, il faudrait que ceux dont les films sont diffusés ici au Sénégal puissent «payer un certain montant à nos télévisions ».
La question du financement, justement, est une question fondamentale. Pendant de nombreuses années, le cinéma sénégalais a dû vivre de soutiens extérieurs. Ce qui explique pourquoi, selon Hugues Diaz, « nos films étaient plus des films pour des festivals ou pour une certaine tranche de population », un public européen ou étranger. Il raconte comment, au cours de ces Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK), certains dans le public étaient loin de se douter que ces films-là existaient. Or un film qui n’est pas vu, c’est un peu comme s’il n’avait jamais été produit.
Ce qui pose immanquablement l’éternelle question des infrastructures, celle des salles de cinéma. Le directeur de la Cinématographie rappelle que l’Etat a rénové et équipé des salles qui n’étaient pas fermées: « ce sont des salles classiques implantées dans des quartiers populaires : les cinémas Awa de Pikine, Médina de Tilène, Bada Sy de la Gueule Tapée et Christa de la Patte d’Oie ».
Des salles où au-delà des prouesses techniques et autres effets spéciaux, ce qui compte, selon Baba Diop, « c’est de pouvoir donner une âme à l’histoire, parce que c’est cela qui nous émeut. On retient rarement les défauts techniques quand l’histoire nous émeut, nous parle à travers un personnage. Et l’âme d’un film traverse toutes les frontières ».
Source:http://www.sudonline.sn/le-7eme-art-senegalais-plus-ou-moins_a_22247.html