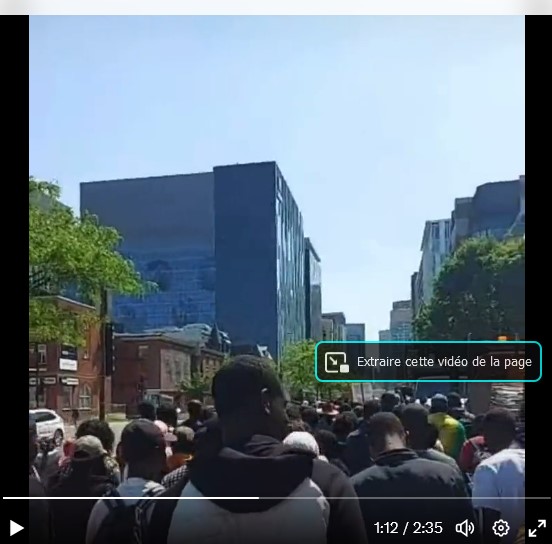Fast backlinks and Guest-post hosting
Sud quotidien publie les Bonnes feuilles (1) de : "Abdou DIOUF. Mémoires", un ouvrage important qui dévoile un pan de l'histoire contemporaine du Sénégal. On y découvre en filigrane les différentes facettes de Senghor, les péripéties ayant conduit à la rupture Diouf Collin, l'histoire extraordinaire d'une tentative de kidnapping de la fille cadette de Diouf orchestrée par Khadaffi, la duplicité de Wade lors de l'engagement militaire du Sénégal en Gambie. L'ancien chef de l'Etat du Sénégal Abdou Diouf, vient en effet de publier ses Mémoires aux Editions du Seuil et apporte des éclairages sur la longue carrière administrative et politique qui l'a vu se mettre au service de son pays, de 1960 à 2000. Au cours de ces quarante années , Abdou Diouf y a successivement occupé les postes de gouverneur de Région, directeur de Cabinet et secrétaire général de la présidence de la République, ministre, Premier ministre et enfin président de la République.(1) Les titres et intertitres sont de la rédaction
PREMIERE NOMINATION D'UN PREMIER MINISTER
La révision constitutionnelle de 1970 marque une étape importante dans la vie de la jeune nation sénégalaise puisqu’elle consacre le principe de la déconcentration des pouvoirs du président de la République par la création d’un poste de Premier ministre.
Pendant tout le débat constitutionnel, beaucoup de noms ont été avancés. Pour certains, il ne fallait pas me nommer car j’étais encore très jeune. Pour d’autres, Cheikh Fall, alors PDG d’Air Afrique, pourrait peut-être faire l’affaire, mais il était trop à l’international. Pour d’autres encore, il fallait nommer d’abord quelqu’un comme Clédor SalI, il avait plus de maturité, et on me mettrait plus tard. Ce dernier point de vue était celui du général Jean-Alfred Diallo, qui aurait dit: «Abdou, si on lui presse le nez, il en sort du lait.» C’était aussi celui du député Pierre Senghor, frère aîné du Président, qui pensait qu’il fallait en passer par là en attendant ma maturité. Bref, nombreux étaient ceux qui disaient à Senghor de porter son choix sur d’autres que moi. Toutes sortes de méthodes ont été utilisées pour me sonder et savoir ce que j’en pensais. Je n’ai jamais voulu en parler ouvertement.
J’ai continué à faire mon travail, jusqu’au jour où Antoine Tabet, un grand ami de Senghor, se présenta en urgence à mon bureau et demanda à me voir. il était 20 h 30, j’avais terminé mes audiences et j’étais à ma table de travail, plongé dans mes dossiers, avant de regagner mon domicile et de retrouver ma famille après une longue journée de travail. J’étais un peu contrarié, mais je le reçus néanmoins. Il me dit: «Abdou, tu dois réagir, car les gens sont en train de faire un travail de sape chez le Président. Ils lui ont dit que tu n’avais pas envie de faire face à cette responsabilité. Lui m’a soufflé que tu étais parmi ses choix, mais que tout le monde lui disait que tu ne voulais pas prendre ce poste.» Il me conseilla de parler au président Senghor et de lui dire que non seulement aucune responsabilité ne m’effrayait, mais encore que j’étais à sa disposition et que c’était à lui de décider. Je suivis le conseil d’Antoine Tabet.
Quelques jours après, au début de mon audience hebdomadaire du lundi, je m’adressai au Président en ces termes: «Monsieur le Président, il me revient qu’on vous aurez dit que je n’ai aucune envie d’assumer de plus hautes responsabilités. Je tiens cependant à vous dire que je suis à votre entière disposition pour toute mission que vous voudriez bien me confier. Vous me connaissez beaucoup mieux que ceux qui parlent à tort et à travers. Je suis à votre disposition. » Après ces mots, je passai à l’objet de ma séance de travail, mais je vis tout de suite qu’il était très ému. Les supputations continuèrent et Senghor laissa faire. On parlait non seulement de moi, mais encore de Cheikh Fall, de Daniel Cabou ou d’Amadou Cissé Dia.
J’ai continué à faire mon travail, jusqu’au jour où Antoine Tabet, un grand ami de Senghor, se présenta en urgence à mon bureau et demanda à me voir. il était 20 h 30, j’avais terminé mes audiences et j’étais à ma table de travail, plongé dans mes dossiers, avant de regagner mon domicile et de retrouver ma famille après une longue journée de travail. J’étais un peu contrarié, mais je le reçus néanmoins. Il me dit: «Abdou, tu dois réagir, car les gens sont en train de faire un travail de sape chez le Président. Ils lui ont dit que tu n’avais pas envie de faire face à cette responsabilité. Lui m’a soufflé que tu étais parmi ses choix, mais que tout le monde lui disait que tu ne voulais pas prendre ce poste.» Il me conseilla de parler au président Senghor et de lui dire que non seulement aucune responsabilité ne m’effrayait, mais encore que j’étais à sa disposition et que c’était à lui de décider. Je suivis le conseil d’Antoine Tabet.
Quelques jours après, au début de mon audience hebdomadaire du lundi, je m’adressai au Président en ces termes: «Monsieur le Président, il me revient qu’on vous aurez dit que je n’ai aucune envie d’assumer de plus hautes responsabilités. Je tiens cependant à vous dire que je suis à votre entière disposition pour toute mission que vous voudriez bien me confier. Vous me connaissez beaucoup mieux que ceux qui parlent à tort et à travers. Je suis à votre disposition. » Après ces mots, je passai à l’objet de ma séance de travail, mais je vis tout de suite qu’il était très ému. Les supputations continuèrent et Senghor laissa faire. On parlait non seulement de moi, mais encore de Cheikh Fall, de Daniel Cabou ou d’Amadou Cissé Dia.
LE LIT DU PREMIER MINISTRE
Au sujet de ces supputations, me revient une anecdote plaisante En prévision de la nomination du Premier ministre, Senghor avait fait procéder à d‘importants travaux du Petit Palais, résidence officielle du chef du gouvernement. On en profita pour essayer encore une fois de lui tirer les vers du nez :
« Vous nous avez demandé de rénover le Petit Palais, c‘est chose faite, mais reste le problème du choix du lit.
- Quel lit?
- Le lit du futur Premier ministre.
- Et alors?
- Il faut qu’il soit aux dimensions.
- Quels sont les noms qui sont avancés? leur demanda Senghor.
- On parle d’Abdou Diouf.
- Mettez un lit très long.
- On parle aussi de Cheikh Fall.
- Mettez un lit très large.
- On parle également de Daniel Cabou.
- Il se trouvera bien là-dedans si le lit est long et large.»
Jusqu’à la veille de la promulgation de la loi constitutionnelle issue du référendum du 22 février, personne n’était encore fixé. Je me rappelle la petite discussion que j’ai eue le mercredi 25 février avec Caroline Diop, toujours assise près de moi aux réunions de notre Bureau politique. «N’est-ce pas que c’est demain que le président Senghor va nommer son Premier ministre? Ne t’a-t-il pas contacté?» me dit-elle. Je répondis par la négative. «Donc ce n’est pas toi qu’il va nommer», conclut-elle. Ainsi, jusqu’au mercredi soir à 20 heures, le président Senghor ne m’avait encore rien dit. Je dormis du sommeil du juste, à tel point que ce jeudi-là, 26 février 1970, exceptionnellement, j’arrivai au bureau avec dix minutes de retard. À 8 h 10, le téléphone sonna. Au bout du fil, le président Senghor me dit: «Bonjour, Abdou. Tu peux venir me voir au Palais, s’il te plaît?»
Tout le monde attendait et se disait que celui qui entrerait en premier dans le bureau du Président serait nommé Premier ministre. Dès que j’entrai, le Président appela Daniel Cabou, qui étai ministre secrétaire général de la Présidence de la République, et s’adressa à moi:
«Abdou, avant qu’on ne parle, je te demande d’abord: est-ce que tu veux être mon Premier ministre ?
- Oui, monsieur le Président», répondis-je.
Il promulgua la loi constitutionnelle, puis signa le décret me nommant Premier ministre. Il demanda ensuite à Daniel Cabou d’assurer l’enregistrement et la diffusion de la loi constitutionnelle et du décret de nomination du Premier ministre. Il me fit asseoir à coté de lui et me parla longuement: «J’ai beaucoup d’affection pour toi, mais ce n’est pas pour ça que je t’ai nommé. Je t’ai choisi parce que je considère que tu es l’homme qu’il faut. Tu es l’homme de la situation, et la majorité des camarades du parti que j’ai consultés ont porté une très bonne appréciation sur ton travail et tes qualités. Jusqu’à présent, quand je t’écrivais, je disais: “Mon cher ministre”. Désormais je dirai: “Monsieur le Premier ministre”. C’est plus distant, mais plus respectueux.»
Ce respect ainsi que l’affectueuse considération qu’il avait pour moi, j’ai pu les constater très vite, car dès que nous avons emménagé au Petit Palais, qui était la résidence officielle du Premier ministre, Mme Senghor téléphona à mon épouse pour demander à venir la voir. Malgré les protestations de ma femme, elle insista pour se déplacer. Elle tenait, à sa manière, à montrer à tout le Sénégal la confiance que son époux et elle-même accordaient au Premier ministre et à son épouse. Ma femme s’inclina et Mme Senghor, accompagnée de son fils unique, Philippe Maguilène, vint rendre visite à Mme Élisabeth Diouf dans sa résidence officielle.
LES PARAS SAUTENT SUR BANJUL
C'est en juillet de cette même année 1981 que survinrent les événements de Gambie.
Ce jour-là, je recevais David Libon, un ami israélien, conseiller non rémunéré du gouvernement mais qui nous aidait dans la conception du plan et dans la recherche d'investissements privés.
Soudain, le téléphone blanc, qui est le téléphone de sécurité, sonna et j'eus d'abord le Premier ministre Habib Thiam, qui me fit savoir que des rebelles venaient de s'emparer du pouvoir en Gambie. Tout de suite après, ce fut au tour du ministre des Forces armées, Daouda Sow, puis du général Fall, chef d'état-major des armées, toujours avec le même message: en l'absence du président gambien Daouda Diawara parti en Angleterre assister au mariage du prince Charles, des rebelles, sous la conduite d'un nommé Kukoy Samba Sagna, s'étaient emparés du pouvoir.
Je continuais à discuter avec M. Libon tout en réfléchissant à une réaction. Malgré l'urgence de la situation, je n'ai pas perdu un mot de ce que disait mon interlocuteur. On a coutume de dire que c'est quand le temps est à l'urgence qu'il faut prendre celui de réfléchir. La réflexion a duré à peine un quart d'heure parce que je me suis tout de suite dit que ces rebelles allaient installer le chaos, non seulement en Gambie, mais aussi au Sénégal. La Gambie est certes un État souverain, mais géographiquement il est à l'intérieur du Sénégal. J'ai donc donné l'ordre à l'armée sénégalaise d'aller en Gambie pour rétablir le pouvoir légal du président Diawara.
Il est vrai qu'une décision comme celle-là, on est seul à la prendre quand on est chef d'État; les gens viennent à vous, mais c'est pour vous donner des informations et prendre des instructions, étant entendu que la décision vous revient.
David Libon, témoin fortuit de ces instants, me voyant répondre au téléphone, réfléchir et prendre rapidement ma décision, n'a pu s'empêcher de s'exclamer: « C'est extraordinaire! Il faut que je le raconte. » C'est ce qui lui a fait dire après: « J'ai été témoin, une fois dans ma vie, de la manière tout à fait solitaire dont un chef d'État est appelé à prendre certaines décisions.» C'est quand l'armée est arrivée que l'on s'est rendu compte que les rebelles avaient bien préparé leur coup. Ils étaient partout, aussi bien sur les ponts qu'aux carrefours. J'ai continué à suivre la situation de mon bureau et ai pris en main l'aspect diplomatique.
Il y avait deux choses à considérer: faire libérer la première épouse de Daouda Diawara et ses enfants, dont les rebelles s'étaient emparés, et aller chercher Diawara et sa seconde épouse en Angleterre.
QUAND KADHAFI VEUT KIDNAPPER YACINE
Les Américains virent d’un très mauvais œil cette visite du guide libyen au Sénégal. Dans une note très dure, ils manifestèrent leur étonnement de voir un pays ami recevoir un ennemi des États-Unis, adepte du terrorisme, dont les exactions tuaient leurs enfants. Je me devais de réagir. Sur un ton très ferme, je répondis aux Américains par une lecture des réalités politiques mon pays, qui dictaient avant tout ma conduite. Cette mise au point fut bien comprise, puisque les relations entre le Sénégal les États-Unis continuèrent sans heurt. J’en veux pour preuve les honneurs que je reçus par la suite d’universités américaines, sous forme de prix ou de doctorat honoris causa, et la seconde visite d’État que j’effectuai en 1991 dans ce pays, à l’invitation du président George Bush père.
Pour en revenir à Kadhafi, me revient en mémoire une péripétie qui m’avait fort embarrassé, et dont je souris aujourd’hui en rédigeant ces lignes. Cette anecdote est révélatrice de la complexité du personnage. Au cours de sa visite officielle au Sénégal, nous eûmes quelques moments d’intimité avec nos familles respectives. Il eut l’occasion de faire la connaissance de tous mes enfants dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Au terme de son séjour, il rentra à Tripoli avec un autre regard sur ce Sénégal qui l’intriguait tant avant qu’il eût l’occasion de fouler son sol. Quelque temps après, quelle ne fut ma surprise lorsqu’il dépêcha auprès de moi une délégation porteuse d’un message des plus surprenants: il demandait la main de Yacine, ma fille cadette, alors âgée de 16 ans. J’aurais pris ce message pour une blague de mauvais goût, n’eût été la respectabilité que j’accordais à cette délégation. Tout naturellement et sans trop m’attarder sur la question, je répondis négativement à cette surprenante demande. Peu de temps après, Kadhafi revint à la charge en envoyant à nouveau une autre délégation. Je reçus ses émissaires qui me transmirent le message de leur mandataire. Pour couper court, j’opposai à nouveau un refus, cette fois-ci plus catégorique, avec une pointe d’agacement bien perceptible.
Entre-temps Yacine obtint son baccalauréat et s’inscrivit dans une université américaine, à Washington, où elle rejoignit ses deux frères.
Alors que je pensai cette affaire définitivement close, elle rebondit quelque temps après en prenant une nouvelle tournure. Kadhafi était tenace et n’aimait pas qu’on dise non à ses caprices. Pour obtenir gain de cause, il fit appel à une dame d’origine moyen-orientale que je connaissais bien et qui était aussi une connaissance de Cheikh Hamidou Kane, mon aîné à l’ENFOM, lequel était aussi, au moment de ‘cette affaire, mon ministre du Plan et de la Coopération. Les deux premières tentatives ayant été infructueuses, Kadhafi décida de passer à la vitesse supérieure en utilisant un autre moyen qu’il exposa à cette dame qui faisait beaucoup d’affaires avec la Libye. Devant le refus cette dernière, il gela toutes ses affaires et la contraignit à rester sur place avec interdiction de quitter le territoire. Pour se tirer d’affaire et surtout sortir du pays, la dame accepta d’exécuter le plan: organiser l’enlèvement de ma fille pour ensuite la conduire en Libye où Kadhafi se chargerait de la convaincre d’accepter le mariage.
Par amitié pour moi, elle me fit alors la confidence du projet dont elle était chargée. Je pris la menace très au sérieux, car elle venait d’un homme dont le monde entier savait de quoi il était capable. Je me dis que ce projet n’était rien à côté de ce que l’on savait déjà de lui, et qui l’avait mis un moment au ban de la société mondiale.
Puisque ma fille séjournait aux États-Unis pour ses études, c‘est tout naturellement que je me tournai vers les hautes autorités de ce pays pour leur demander d’assurer sa sécurité. Elles le firent de façon efficace et très discrète. Aujourd’hui encore, en relatant cette histoire; je ne peux m’empêcher de penser à la désapprobation que les Américains avaient exprimée lorsque le Sénégal, qui est un pays ami, avait décidé d’accueillir ce troublant chef d’État, avec lequel nous avions cependant des relations. Et le cocasse dans cette histoire est dans le fait que ce sont eux qui m’ont aidé à éviter le pire.
DOUBLE JEU D'ABDOULAYE WADE
(…) Il y a eu beaucoup de“ réactions au cours de cette période mouvementée. Presque tous les chefs d’État africains m’ont téléphoné. Du président Sékou Touré de Guinée au roi Hassan II du Maroc en passant par le président Pereira du Cap-Vert, tous m’ont appelé pour s’enquérir de la situation. Si Sékou Touré optait pour une négociation avec les preneurs d’otages, Hassan II me conseillait, lui, d’aller jusqu’au bout de l’action entreprise. Bien sûr, j’informai également mon prédécesseur, le président Senghor, qui me donna des conseils avisés, comme toujours.
Le président Mamadou Dia de son côté demanda à me voir:
«Abdou, me dit-il, je suis venu te demander de retirer tes troupes parce que Daouda Diawara ne vaut pas une goutte de sang sénégalais; et puis, qui te dit que ces gens-là sont contre toi?
Tu n’as pas le droit.»
Je lui dis que, d’après mes informations, ces rebelles constituaient un danger pour la Gambie mais aussi pour le Sénégal, et que j’étais obligé de poursuivre l’action militaire déjà engagée.
Il s’est levé et m’a dit: «Abdou, je te le redis et, cette fois, ce n’est plus le responsable politique qui te parle mais c’est un conseil de père à son fils, rappelle tes troupes.»
De son côté, Abdoulaye Wade y est allé de ses déclarations : «Mais Abdou Diouf a tort, ce n’est pas possible, on ne peut pas envahir un pays souverain, c’est inacceptable. » Il demanda cependant à me voir et me dit : «Si j’étais à ta place, j’aurais fait la même chose, vraiment j’aurais agi comme tu l’as fait. Cependant, si tu répètes ce que je viens de te dire, je démentirai.» J’étais conforté dans ma décision et je restai ferme.
Finalement, les rebelles décidèrent d’abandonner la partie, de libérer les otages - notamment l’épouse et les enfants du président Diawara - et de s’enfuir. Daouda Diawara put rentrer dans son pays, débordant de reconnaissance. L’armée sénégalaise eut pour mission de le protéger ainsi que toutes les institutions et le peuple gambien.
C’est dans cet état d’esprit qu’il est revenu me parler du projet de confédération entre nos deux pays. Il m’a dit «Je te remercie beaucoup de ton aide. Maintenant, nous devons vraiment tout faire pour que pareille situation ne se reproduise plus. »
RUPTURE AVEC JEAN COLLIN
Le fait le plus important de l’année 1990 fut ma séparation avec Jean Collin. Personne ne pouvait l’imaginer, après le long compagnonnage que j’avais eu avec cet homme.
Tout s’accéléra à partir de son mariage avec Marianne Turpin, qui joua un grand rôle dans la dégradation de nos relations. Ma collaboration étroite avec Collin se poursuivit sans heurt jusqu’au jour où je remarquai chez lui de grands changements. Soudain, il se mit à voyager sans cesse. Les tentatives d’explication de ces voyages allaient bon train.
Certains évoquaient des problèmes de santé, alors que d’autres parlaient carrément d’espionnage. Toujours est-il que la tâche m’était rendue difficile.
En 1986, je rencontrai une haute personnalité politique française, qui me brossa un tableau très sombre des activités de Collin à l’occasion de ses fréquents voyages. Évidemment, je défendis énergiquement mon collaborateur.
Les choses restèrent en l’état jusqu’en 1987, au sommet de la Francophonie de Québec. Je reçus à cette occasion à déjeuner le président Senghor, qui me demanda à son tour -avec les mêmes arguments- de faire partir Jean Collin. Je m’évertuai alors à prendre sa défense, en faisant observer au président Senghor qu’il était impossible d’agir de la sorte avec quelqu’un qui vous avait servi avec loyauté pendant de si nombreuses années.
Peu convaincu par mes arguments, le président Senghor me répondit: «Non, non, c’est un bandit. Méfie-toi de lui, c’est un bandit1. »
Nous en étions à ces tergiversations sur les voyages de Jean Collin lorsque se développa cette histoire idiote des Amis de Jean Collin, qui était en quelque sorte un comité de soutien. Au prétexte de diffuser ses idées politiques, le devant de la scène fut alors occupé au Sénégal par toute une série d’opportunistes, dont Aïda Ndiongue. Les meetings se suivaient à une cadence infernale. Je connais bien les mouvements de soutien pour en avoir bénéficié, mais j’ai su les canaliser.
Dans ma perception des choses, les gens étaient libres de me soutenir s’ils le voulaient, mais je ne donnais en retour aucun privilège. Beaucoup de personnes le savaient, d’ailleurs. Hélas, telle n’était pas la vision des Amis de Jean Collin. A un moment, on avait l’impression de l’existence de deux pouvoirs au Sénégal, incarné l’un par Collin, et l’autre par moi-même. Il y eut même des répercussions de ces désordres dans les relations de nos épouses.
MARIANNE COLLIN SNOBE ELISABETH DIOUF
Ma femme Élisabeth, connue pour sa grande discrétion, avait l’habitude d’aller présider la kermesse de Ziguinchor, surtout par amitié pour l’abbé Lucien Basse, curé de la paroisse, et aussi par affection pour le ministre d’État Robert Sagna, maire de Ziguinchor. En outre, ce geste s’inscrivait dans le cours normal des activités de l’épouse du chef de l’État. Une fois, en y allant, elle trouva déjà sur place Mme Collin, qui était arrivée avec une kyrielle de dames constituant sa «garde d’honneur». Mon épouse, elle, s’était rendue à la cérémonie plus simplement, avec son protocole et la sécurité. A la coupée de l’avion, Mme Collin ne vint pas à sa rencontre. On ne saurait le lui reprocher, le fait ne revêtant aucune gravité. En revanche, c’est pendant la kermesse que survinrent des faits vraiment déplacés, frisant la désinvolture et l’irrespect. C’était proprement ahurissant.
En effet, Mme Collin s’arrangea pour constituer son propre groupe, qui faisait face à celui de mon épouse. Le soir, au cours du dîner chez le gouverneur de région, mon épouse invita Mme Collin à venir à sa table. Celle-ci déclina l’invitation, en lui faisant comprendre qu’elle avait sa table, avec ses invités.
Lorsque mon épouse me raconta ces faits, je commençai à trouver les choses bizarres, surtout quand je faisais le rapprochement avec d’autres événements récents sur lesquels je ne m’étendrai pas.
Diouf à Collin : ”Je te libère”
À plusieurs reprises, après les élections de 1983, puis celles de 1988, Jean Collin m’avait pourtant signifié son intention de prendre sa retraite politique. Je lui avais toujours opposé un refus, en lui faisant comprendre que j’avais encore besoin de lui. Je suis persuadé qu’il tenait de tels propos, repris encore en 1988, pour me mettre à l’aise. J’avoue que cette année-là il m’avait bien aidé à gérer la situation.
Mon conseiller juridique, Philippe Bas, me dit un jour qu‘il avait l’impression que le ministre d’État ne voulait plus rester au gouvernement. Philippe Bas alla même plus loin, en rapportant que Collin lui aurait dit que le Président le forçait toujours à rester, alors que son seul souhait était d’aller se reposer. J’appelai Jean Collin pour lui dire: «Philippe Bas m’a fait ta commission. Je te libère.» D’abord, il ne me dit rien. Puis il me remercia. Par courtoisie, je lui lu la liste des membres du nouveau gouvernement. Sur celle-ci figurait le nom de Famara Sagna, qui avait déjà dirigé divers départements ministériels et que je nommais ministre de l’Intérieur.
Je rappelle que, dès le début de la rébellion casamançaise, Famara Sagna fut le premier à venir nous voir, Jean Collin et moi, pour se mettre patriotiquement à nos côtés. Jean Collin lui-même m’avait toujours poussé à nommer Famara dans le gouvernement. Mais cette fois, lorsqu’il vit sur la liste que je lui montrais le nom de celui-ci comme ministre de l’Intérieur, Collin me dit qu’il ne comprenait pas l’importance que j’accordais à Famara Sagna, qui ne le méritait pas. Je lui fis alors comprendre que telle était ma décision. J’avais besoin de nommer André Sonko, jusque-là en charge du ministère de l’Intérieur, au secrétariat général de la Présidence. Je mis donc Famara Sagna à l’Intérieur, où il fut un très bon ministre. Je n’aurais d’ailleurs jamais dû l’enlever de ce poste quelque temps après.
Collin s’emmure dans le silence
Lorsque Jean Collin finit de prendre connaissance de ma décision, il quitta mon bureau. Par la suite, il s’emmura dans un silence total et refusa de répondre aux coups de téléphone que je lui destinais. En fin de compte, je ne pus voir Jean Collin jusqu’à son départ du Sénégal pour la France.
C’est à son retour de France, des mois après, qu’il me parla au téléphone depuis Louga, où il était de passage. Il rentrait de Saint-Louis où il était allé voir un commerçant du nom d’Amadou Ka. Ce coup de fil n’était pas fortuit, puisqu’il le passa de la maison de mon oncle Djily Mbaye. Il se limita alors à me remercier à nouveau et dit beaucoup de bien à mon endroit.
Après, je ne le revis plus. Cela ne m’empêcha pas d’intervenir une fois en sa faveur. En effet, lors d’un séjour qu’il fit en Normandie, Jean Collin fut convoqué par la police française, qui, sans doute dans le cadre de l’enquête sur l’attentat du vol UTA, voulait l’interroger sur une affaire de destruction de preuves. Il s’agissait du Semtex, explosif que détenaient les Libyens qui avaient été arrêtés au Sénégal. Ces derniers avaient été piégés par Ahmed Khalifa Niasse, qui les avait d’abord conduits au Bénin, avant de les amener au Sénégal, en prenant soin de nous prévenir. Nous avions pu ainsi les arrêter dès leur arrivée pour les renvoyer à Khadafi, qui jura sur le Coran qu’il n’y était pour rien et se proposa dès leur retour à Tripoli de les incarcérer et de les juger. Toujours est-il que cette affaire rebondit avec la convocation devant la police, en France, de Jean Collin.
(…) Bien entendu, Jean Collin fut relâché dans la journée. Depuis ce jour, je ne reçus pas de nouvelle de lui, jusqu’à son décès.
C’est donc le 27 mars 1990, après une présence de près de trois décennies dans les sphères du pouvoir et de l’administration de la République, que Jean Collin quitta la scène politique sénégalaise.
LA PREMIERE ALTERNANCE politique SE DESSINE
Le jour du second tour, le l9 mars 2000, au fur et à mesure que me parvenaient les chiffres du scrutin, je me faisais une idée de la suite. J’étais dans ma chambre, entouré de ma famille. Habib Thiam me tenait régulièrement informé des résultats diffusés par les radios. Les chiffres tombaient et, par la volonté exprimée dans les urnes, le pouvoir que m’avait confié le peuple était en train de basculer vers le camp adverse. Je n’avais plus de doute, le peuple sénégalais était en train de s’offrir sa première alternance politique après quatre décennies de présence de notre parti à la tête du Sénégal.
Seul avec les miens, devant Dieu et face à l’Histoire, le film de ma vie publique défila devant moi en quelques secondes en une sorte d’effet synoptique, depuis le jour de l’avion qui devait me ramener au Sénégal et que je n’avais pas pris et qui s’était abîmé en mer, jusqu’à ce moment où, dans la matinée du 19 mars 2000, en compagnie de ma femme et de mes enfants, j’avais déposé mon bulletin dans l’urne dans mon bureau de vote, situé dans une salle de classe de l’école Berthe-Maubert de Dakar. Puisant au plus profond de moi, avec toutes mes forces et toute ma foi, j’ai rendu grâces à mon Dieu qui m’avait comblé de mille manières. J’ai pensé à mon père disparu, à ma mère à Louga. J’ai pensé à ma merveilleuse épouse et à mes enfants.
J’ai pensé à nombre de mes amis d’une fidélité à toute épreuve.
J’ai pensé à mon pays et à mon brave peuple, ce peuple dont la majorité avait répondu à l’appel pour le changement. J’ai également pensé aux 42 % des Sénégalais, qui avaient voulu m’accompagner encore pour un bout de chemin, malgré les démissions, les trahisons et les corruptions, mais aussi malgré toutes les calomnies et autres incroyables contrevérités dites sur moi et sur ma famille.
J’ai pensé longuement à ce brave peuple sénégalais qui, depuis quelques années, s’était serré la ceinture pour nous permettre de voir le bout du tunnel. J’ai revu, défilant devant moi, mes moments remplis de joies et de peines, de doutes et d’espoir.
Et je me suis de nouveau retranché dans la demeure intérieure de ma conscience face à l’Histoire. J’ai dialogué avec moi-même.
J’ai écouté une voix intérieure qui m’a parlé. Ma retraite intérieure fut un moment interrompue par mon ami Habib Thiam. Nous discutâmes longuement de la tournure prise par les choses et nous conclûmes que les jeux été faits: j’étais battu. Et je lui dis que j’en tirais toutes les conclusions et que j’étais prêt à assumer pleinement cette défaite.
Diouf félicite son adversaire
J’ai entendu à nouveau ma propre voix. Cette voix qui est au plus profond de soi, au moment où on est seul avec soi-même. Moment de solitude dans la solitude. Moment de profonde et intense réflexion. Moment de prise de décision, moment de prise de la décision. Bien après Platon dont on connaît les fameux dialogues, saint Augustin lui aussi laissera à la postérité des passages éblouissants sur le dialogue. Si le philosophe grec met en scène plusieurs protagonistes, l’homme de foi, lui, discutera avec lui-même dans une sorte d’échange dont le but n’est plus d’aboutir à des idées ou à des conceptions, mais de parvenir au moi, ce moi profond qui ne peut être atteint que par un dialogue intérieur. Pour l’auteur des Confessions, ce dialogue se nomme « Soliloque». C’est ce que Rousseau, lui aussi auteur de Confessions, fera dans son Rousseau, juge de Jean-Jacques. C’est ce que je fis en cette nuit électorale au cours de laquelle, plongeant au plus profond de moi, je pris la décision de reconnaître ma défaite et de féliciter mon adversaire. Et, pour cela, je n’ai eu besoin de personne pour me dicter ce que ma conscience et ma raison, mon sens de l’honneur et de la responsabilité, m’imposaient comme seule attitude possible.
Non, je n’ai jamais voulu m’accrocher au pouvoir. Je n’ai jamais voulu aller à contre-courant de la volonté clairement exprimée d’un peuple qui m’a longtemps fait confiance, et qui m’a beaucoup donné. Je ne suis pas homme à m’accrocher à un pouvoir que j’ai perdu par les urnes. Les Sénégalais ont encore en mémoire mon peu de combativité vers la fin, car j’avais senti que le peuple voulait l’alternance.
ECHANGE AVEC BABACAR TOURE
Cette nuit-là, vers 23 heures, mon ami Babacar Touré, président du groupe de presse Sud Communication, m’a appelé. Je lui ai annoncé que j’avais perdu. Il m’a dit: «Monsieur le Président, voulez-vous faire une déclaration?» Je lui ai répondu: «Je ne veux pas faire de déclaration orale, je veux faire une déclaration écrite, parce qu’à partir du moment où quelqu’un d’autre a gagné, je ne veux plus qu’on entende ma voix. Je suis maintenant dans l’ombre, c’est lui qui doit être en pleine lumière. Mais demain matin, à la première heure, j’enverrai une déclaration écrite. »
Babacar Touré en a d’ailleurs porté témoignage quand je suis devenu secrétaire général de la Francophonie, lorsqu’il m’a invité à la conférence de la rédaction du journal Sud Quotidien.
Le lendemain, je me suis réveillé très tôt et je suis allé à mon bureau pour appeler Wade, le féliciter. Je tenais à le faire avant de publier ma déclaration. Je n’ai pu l’avoir au téléphone du premier coup. J’ai donc reçu mes collaborateurs: Bruno Diatta, ambassadeur et chef du protocole, Ousmane Tanor Dieng, Cheikh Tidiane Dièye, conseiller spécial en communication. J’ai ensuite demandé à mon secrétaire d’appeler à nouveau Wade en insistant:
«Tu rappelles et tu insistes, il faut absolument que je lui parle, et tout de suite.» Il est tombé sur Pape Samba Mboup, qui est parti chercher Wade. Je l’ai félicité chaleureusement en lui souhaitant plein succès pour lui, pour le pays. J’ai ajouté que j’étais à son entière disposition pour une rencontre en vue de la prestation de serment et de la passation de service. C’est à ce moment que j’ai envoyé ma déclaration, qui était prête depuis le matin à la première heure.
On boucle les valises
Après avoir reconnu la victoire de Wade, il fallait sans tarder organiser le déménagement du Palais de la République. Quand on a habité un lieu pendant vingt ans, on accumule beaucoup de choses. Ma femme commençait à faire les bagages, et moi je mettais de l’ordre dans mon bureau pour préparer les dossiers à transmettre à mon successeur. Le lendemain, j’ai reçu un coup de téléphone de ma mère, qui m’a dit: «Abdoulaye Wade vient de me rendre visite. Je voulais t’en rendre compte, il a dit de bonnes paroles; moi aussi, j’ai dit de bonnes paroles. »
Après cela, Abdoulaye Wade a demandé à me voir, je l’ai reçu, je l’ai félicité à nouveau, et nous avons échangé des propos pleins de cordialité. À la fin, je lui ai dit: «Mais quand est-ce que tu veux prêter serment? Je suis en train de me préparer, mon mandat se termine le 3 avril, mais choisis la date que tu veux. » Il m’a dit: «Ah oui, oui, je pensais au 31 mars.» J’ai appelé Bruno Diatta; qui a souligné qu’il fallait «préparer l’Assemblée nationale », car c’est là qu’on avait l’habitude de faire la prestation de serment.
Puis j’ai dit à Wade: «Je suis à ta disposition. Dans mon agenda, c’est toi qui as la priorité. » Après quoi il m’a téléphoné pour me dire que, finalement, il avait choisi la date du 1er avril mais qu’il voulait prêter serment non pas le matin comme nous l’avions toujours fait avec le président Senghor, mais l’après-midi. Il a ajouté qu’il voulait que la cérémonie ait lieu non pas à l’Assemblée nationale, mais au stade, ce que j’ai accepté. Il a ajouté qu’il voudrait aussi qu’on invite quelques chefs d’État africains.
Le Conseil constitutionnel refuse le stade
J’ai dit: « Donne-moi la liste, je m’en occupe. » J’ai envoyé des lettres d’invitation à tout le monde et, mieux, j’ai accompagné cela de coups de téléphone, parce que je voulais être sûr que ces personnalités feraient bien le voyage, car ils pouvaient se dire: « Ils nous écrivent pour la forme. » J’ai téléphoné à chacun pour lui dire que je tenais à ce qu’il soit présent. Ensuite Bruno Diatta m’a dit: « Il y a un problème: le Conseil constitutionnel refuse le stade. La prestation de serment est une audience. On ne peut tenir une audience dans un stade. Pour le Conseil, la prestation de serment se fera soit à l’Assemblée nationale, soit au siège du Conseil.»
J’ai répondu: « Il ne faut pas que la fête soit gâchée. On vient d’organiser de belles élections, transparentes, loyales, justes, et le monde entier nous salue. Si maintenant la discorde survient pour une histoire de prestation de serment, ce sera du plus mauvais effet.» J’ai appelé Youssou Ndiaye, président du Conseil constitutionnel, et je lui ai dit: « Youssou, ce n’est pas le Président qui te parle, c’est le frère et l’ami. Je te supplie à genoux d’accepter ce que veut le président Wade. » Il m’a répondu:
« Oui, monsieur le Président, mais il faut alors faire des travaux au stade.
- Tu peux exiger tout ce que tu veux comme aménagement technique, ai-je dit, mais je te supplie à genoux d’accepter pour ne pas gâcher l’image du Sénégal, c’est tellement bien parti.
- Bon, j’accepte, mais il nous faut quelque chose qui nous isole un peu pour donner l’impression que nous sommes en audience. »
Je lui ai dit d’envoyer le devis et que nous allions faire le nécessaire.
Quand Wade est venu me voir, le sommet Europe-Afrique devait se tenir au Caire. Il m’a dit alors: «Je ne pourrai pas aller à la réunion du Caire, je voudrais que tu ailles me représenter.»
Je lui ai dit: «Abdoulaye, j’accepte avec plaisir, c’est un honneur.
J’accepte avec enthousiasme, je te rendrai compte et je serai très discret. »
“La cérémonie des Adieux”
En Égypte, j’ai été reçu comme un chef d’État. Je me suis ensuite rendu au Maroc à l’invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, invitation transmise par son frère le prince héritier Moulaye Rachid venu le représenter à la prestation de serment de mon successeur. J’avais auparavant fait la passation de service après la cérémonie de la prestation de serment. Ensuite, nous nous sommes retrouvés au Palais. Wade était là, avec sa femme et ses enfants, j’y étais moi-même avec ma femme et mes enfants.
Nous avons reçu ceux qui étaient présents, et nous avons visité le Palais. J’ai présenté à Wade le personnel, le grand chancelier de l’Ordre national du Lion, et après cela j’ai pris congé. J’ai passé en revue la garde présidentielle, qui m’a présenté les honneurs, puis j’ai marché jusqu’à la sortie du Palais et me suis engouffré dans ma voiture, accompagné par le chef du protocole. À cet instant, il s’est passé quelque chose d’exceptionnel. Quand Wade était venu au Palais, le cortège avançait aux cris de : «Sopi, sopi, sopi, sopi », un slogan que j’entendais encore lorsqu’il était à l’intérieur. Mais, quand je suis sorti, les «Sopi» se sont subitement tus. Un de mes camarades d’enfance, un de mes grands frères de Saint-Louis qui était dans le PDS depuis le début, Baye Moussa Ba, dit Francky, a alors quitté la foule pour venir me saluer et, au moment où j’allais entrer dans ma voiture, spontanément tous ceux qui criaient: «Sopi, Sopi» se sont mis à applaudir. Partout sur le chemin, ce n’étaient que des applaudissements. À l’aéroport, il y avait là tous mes camarades, étreints par l’émotion. Ils ont même dû soutenir Abdoulaye Diack, tant il pleurait toutes les larmes de son corps.
source:http://www.sudonline.sn/abdou-diouf-se-raconte_a_21692.html