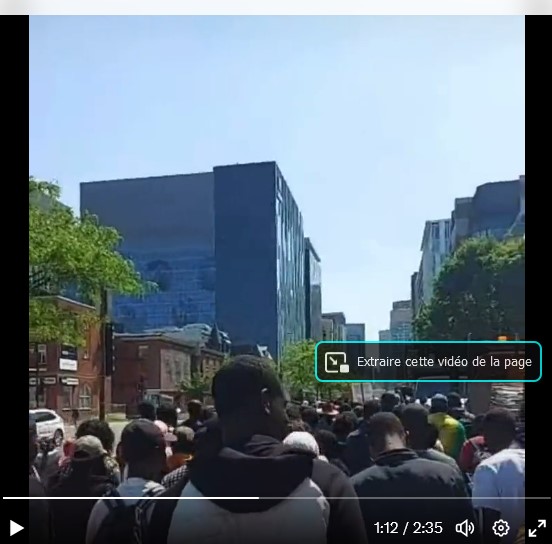Fast backlinks and Guest-post hosting
Dans les couloirs des hôpitaux et des postes de santé, ni le silence, ni la course contre la montre, ni la peur de passer à l’autre monde à tout moment n’effaceront les souvenirs vécus par les praticiens de la santé. Dans ces espaces de silence s’élèvent les flots de confessions d’une perte de vie d’un malade qu’on aimerait sauver. D’autres regrettent toujours leur impuissance face au destin de soigner ou récupérer tel ou tel malade. L’accoutumance est le seul remède qui aide les uns et les autres à vivre dans l’univers du stress permanent.
Les couloirs du service de réanimation fonctionnelle de l’Hôpital général de Grand Yoff sont noirs de monde en cette matinée du jeudi 28 novembre 2013. Les femmes sont curieusement les plus nombreuses. L’espace est plongé dans un silence de cathédrale. Les froufrous des blouses des kinésithérapeutes et des réanimateurs qui passent de salle en salle ne parviennent pas à perturber l’atmosphère. A travers les vitres d’une fenêtre à partir du couloir extérieur, un homme à la barbe poivre et sel pédale une sorte de vélo d’appartement. Dans une autre salle à la porte entrebâillée, Cheikh Seck est au chevet d’un malade. C’est leur train-train quotidien. L’exercice de ce métier a ses particularités. Les praticiens n’oublieront jamais certains faits. Cheikh Seck, les lunettes bien ajustées, garde à jamais dans son esprit son impuissance à sauver un nourrisson, alors qu’il était en poste au centre de santé de Tambacounda. « J’avais vu un membre de ma famille mourir. Mais je suis profondément marqué par la disparition d’un enfant atteint de paludisme chronique que je devais sauver et dont je n’y suis pas arrivé. L’enfant est décédé. Pour moi, c’était un défi de le soigner. Il est finalement décédé. C’était vers 1998 et 1999 », raconte-t-il.
Son débit est saccadé. L’émotion le transperce. Ce n’est pas le seul cas pathétique. A son poste à l’Hôpital général de Grand Yoff, le kinésithérapeute compatit à la paralysie d’une brillante étudiante victime d’un accident de circulation alors qu’elle était en vacances à Joal. Malgré la mobilisation de l’équipe de praticiens, les moyens techniques et le dévouement, elle ne se relèvera pas de sa chaise roulante. « L’étudiante est brillante. Après son accident, elle faisait sa réanimation ici. Malgré la rééducation, elle est paralysée. Elle sera pour le reste de sa vie sur la chaise roulante », se désole Cheikh Seck.
Dans un bureau, Fodé Dramé, un technicien supérieur, affiche la sérénité. Le temps de stress est derrière lui. Il a capitalisé plus de 37 ans de service et a sillonné plusieurs contrées du pays, plus inaccessibles les unes que les autres. Les douloureux souvenirs se bousculent dans sa tête. « Avec le temps, on s’habitue au sang, aux cas graves. Dans les postes à l’intérieur du pays, vous rencontrez tous les jours des cas sociaux où vous êtes obligés de débourser pour soigner les malades. Je l’ai fait à plusieurs reprises », se souvient le technicien. Pour lui, il faut une certaine personnalité pour faire face aux circonstances douloureuses, pathétiques et tragiques. « Nous compatissons tous les jours avec les malades et leurs parents. Mais il faut être fort », insiste cet homme trapu aux épaules rondes. Il a lâché le mot. Il faut être fort sur le plan psychologique pour résister dans les couloirs, dans les salles et dans les blocs où l’on peut tomber à tout moment sur des cas qui suscitent de la compassion.
Contrairement à Fodé Dramé, un étudiant mauritanien inscrit à la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en stage au service d’orthopédie qui vit déjà des expériences inoubliables. « J’avais un malade qui avait une paralysie faciale des nerfs. Il ne pouvait pas parler. Il essayait de parler avec ses parents. Et ces derniers me rapportaient ce qu’il ressentait. C’est sur cette base que je faisais l’examen. C’est difficile », se rappelle-t-il.
 Un métier anxiogène
Un métier anxiogène
Loin de l’Ex-Cto, les allées de l’hôpital Aristide Le Dantec sont animées. Les malades et leurs accompagnants se dirigent les uns vers les services, les autres vers la grande porte. Ici, certains marchent d’un pas lourd en quête de renseignements. Sur l’espace vert non loin du bâtiment administratif, des agents de l’établissement sont en sit-in. Toutefois, dans les services, comme à la Radiographie par exemple, d’autres praticiens sont au chevet des patients. C’est derrière ce bâtiment que se trouve le bloc opératoire. Nous empruntons les escaliers, et nous voici au secrétariat du professeur agrégé en Chirurgie et titulaire de chaire, Cheikh Tidiane Touré. Après quelques minutes d’attente, nous sommes introduits dans le bureau du chirurgien. L’universitaire pianote sur le clavier de son ordinateur. Il est au cœur des préparatifs de trois congrès qui se tiennent simultanément à Dakar du 4 au 6 décembre 2013. Ce Sénégalais qui a officié dans plusieurs pays, Canada, France, Belgique, Gabon, entre autres, livre des sentiments partagés par ses pairs. « La chirurgie un métier passionnant. C’est dommage que les jeunes s’en détournent de plus en plus. Elle fait partie des professions les plus anxiogènes. C’est un défi perpétuel. Au-delà du fait qu’on est devant un patient qu’on doit sauver, c’est un combat contre soi-même. Il faut toujours essayer de s’élever pour améliorer la santé de quelqu’un », confesse-t-il. L’exercice de ce métier requiert de la dextérité mais aussi il faut faire le bon geste au moment qu’il faut. C’est cette exigence qui met les chirurgiens dans le stress quasi permanent. « En fin de compte, la chirurgie est une technique agressive. Prendre un couteau et ouvrir quelqu’un, c’est quelque chose de proscrit. Nous le faisons tous les jours. Mais il faudra qu’on le fasse convenablement. Si le chirurgien ne fait pas le geste qu’il faut au moment qu’il faut, le malade peut mourir ou s’en tirer avec d’importantes séquelles », indique l’universitaire. Le Pr. Touré est marqué par des réussites sur des cas délicats mais il n’oubliera pas une opération en équipe sur un malade à Montpellier pendant 17 heures. C’est un record de sa carrière de plus de 30 ans. « Dix sept heures debout, c’est un exercice physique intense. Au-delà de guérir, c’est un dépassement de soi. Nous ne mangeons pas aux heures qu’il faut », se souvient le chef de la chirurgie générale de l’hôpital Aristide Le Dantec.
Dans les allées pavées de tapis rouges de l’hôtel King Fahd Palace, dans un ensemble wax, ce chirurgien révèle qu’il n’est pas Sénégalais mais Béninois. Un sac à la main, il se meut au milieu de la foule de congressistes. Le chirurgien garde en tête des souvenirs inédits et inoubliables. « Il y a quelques années, nous avons reçu un malade dont l’intestin était perforé. Mais il est resté plusieurs jours avant de se rendre à l’hôpital. Lorsqu’il est arrivé, tout le monde le donnait pour mort. Mais c’est avec des techniques simples et des équipements accessoires que nous l’avions récupéré », révèle le praticien officiant au centre hospitalier universitaire de Cotonou venu assister au Congrès mondial des chirurgiens francophones.
Le tact pour dire la vérité aux familles
Depuis cette expérience, il se garde de se prononcer sur le pronostic vital d’un patient. Dans les salles réservées aux invités, Papa Madiakhaté Sarr, les cheveux blancs, renvoie l’image d’un praticien qui a blanchi sous le harnais. Il a, tour à tour, travaillé dans un ministère comme conseiller avant de revenir à ses vieux amours, comme médecin à la Caisse de sécurité sociale et puis actuellement à la Société africaine de raffinage. Le spécialiste se veut réaliste. « Pour moi, il faut toujours dire la vérité à la famille du patient. Mais il faut savoir comment dire cette vérité », conseille ce sage, qui était aussi venu assister à un hommage que les chirurgiens du Sénégal et d’Afrique rendaient au professeur Adrien Diop, l’un des pères de la chirurgie au Sénégal et dans le continent noir.
La première expérience dans le bloc opératoire
Mardi 10 décembre 2013, au poste de santé de Hann-village, les agents sont à pied d’œuvre. Les derniers patients de la journée sont assis. L’infirmier chef de poste de cette localité, Oumar Sow, est derrière son bureau. Il n’avait pas encore épuisé la liste des malades aux alentours de 14 heures. Le rythme de travail ne prête pas au repos. « Il faut à la fois gérer les malades, les données et tout le matériel. C’est un stress permanent », ajoute-t-il. Dans sa carrière, il est certes marqué par le dévouement de son actuel médecin-chef de district, une femme en quête continue de perfection. Au début, l’infirmier a traversé les expériences d’un débutant. « Lorsque je faisais mon stage dans un bloc opératoire, j’étais perturbé par la vue du sang. C’était la première fois. Pour ce qui concerne la disparition des personnes, c’est dans l’exercice de ma fonction. C’est vrai que lorsque l’on perd un malade, cela fait toujours mal », raconte Oumar Sow. L’exercice d’une spécialité médicale ou paramédicale n’est pas en réalité une promenade de santé.
 CIMETIERES : Le drame de vivre au milieu des morts
CIMETIERES : Le drame de vivre au milieu des morts
Les cimetières de Hann village et de Yoff sont deux espaces si éloignés et si proches. L’atmosphère est immuable. Chaque jour apporte son lot de tristesse, de compassion pour les rares personnes chargées de veiller sur les morts.
Juste avant les locaux du quotidien national « Le Soleil », en venant du côté du Parc de Hann, la succession des maisons cède la place à un mur surplombé par des arbres. Sur la partie relevée, on peut lire : « Commune d’arrondissement de Hann Bel-Air, cimetière de Hann Village ». L’inscription cadre avec l’atmosphère lugubre. Ce samedi 30 novembre, 6 personnes du 3e âge devisent tranquillement à l’entrée. Leurs journées sont immuables depuis une trentaine d’années. « Je suis ici depuis 1985. J’ai embrassé ce boulot par le biais d’un ami qui travaillait dans ce cimetière. Après sa mort, je suis venu pour continuer son œuvre », se rappelle le responsable Talla Mbaye. Pourquoi les jeunes ne travaillent pas dans les cimetières demandais-je à la cantonade ? La réponse est sans appel. « Ce n’est pas un travail pour les jeunes. Ces derniers ne peuvent pas se comporter comme il se doit. C’est un métier dangereux. Il faut une bonne maîtrise de l’espace. Parfois, en creusant, on peut tomber sur le pied ou la tête d’un corps. Tout cela demande une certaine maturité », souligne-t-il.
Drapé dans un grand boubou vert, l’autre septuagénaire, d’une voix basse, parle de son travail avec un voile de mysticisme. Ce n’est pas un travail que chaque personne peut pratiquer, dit-il. « Il faut psychologiquement être fort pour être ici tous les jours et voir les corps », soutient Amadou Bâ.
Au fil du temps, plus rien ne les traumatise. Ces personnes du troisième âge ne sont pas hantées par les cauchemars. « C’est vrai que ce n’est pas du tout facile, mais nous ne craignons rien. Parce que nous savons qu’en creusant la tombe de quelqu’un, d’autres creuseront tôt ou tard les nôtres », dit-il. Ainsi va la vie, peut-on tenter d’ajouter. Ces responsables des lieux extériorisent une certaine fierté de rendre service à la communauté. Derrière le portail du cimetière peint en marron, des plaques portent les noms des disparus, des dates de naissance... Des tombes occupent presque cet espace isolé par ce grand mur. Sous un arbre, le chapelet à la main, un homme vêtu d’un T-shirt blanc se recueille sur les tombes de ses proches. D’autres viendront pour faire de courtes prières avant de s’en aller. « Je vais vous dire que ce que nous gagnons peut couvrir nos besoins que pour une dizaine de jours. Ici à Dakar, nous ne pouvons pas vivre avec 30.000 FCfa. Ce sont les bonnes volontés qui nous laissent quelques pièces en passant et nous aident à vivre », révèle le responsable.
Dans cet endroit gouverné par la solitude et où l’on assiste tous les jours à l’enterrement, on s’aperçoit que la vie ici-bas est si éphémère. Tous compatissent quotidiennement aux douleurs des parents proches ou éloignés des disparus. « Nous ne connaissons pas la joie encore moins la gaité. Ici, c’est l’espace de la tristesse et de la compassion. Vous ne pouvez pas accueillir une personne venue chercher un espace pour enterrer quelqu’un et être content. Il en est de même lorsque nous portons une personne à sa dernière demeure », ajoute Talla Mbaye.
Les philosophes diront que la mort fait partie de la vie. « Le fait que nous voyions des personnes mourir tous les jours consolide notre foi. Parce que nous savons aussi que, tôt ou tard, nous allons mourir. Donc, nous faisons ce qui est recommandé par notre religion », théorise Ahmadou Bâ.
Comme à Yarakh, l’atmosphère est lourde au cimetière de Yoff ce 4 décembre 2013, à 17 heures passées de quelques minutes. Le soleil se couche et ses rayons s’adoucissent. Mais, le temps semble suspendu pour ces hommes debout à l’entrée de l’un des plus grands cimetières musulmans de Dakar. Ils parlent à peine. Plusieurs d’entre eux attendent le corps de leurs proches. En l’espace de dix minutes, deux corbillards accompagnés par des particuliers et des cars « Ndiaga Ndiaye » s’immobilisent au parking. Le gestionnaire, M. Diassy, reçoit, dans un bureau peu spacieux, des personnes endeuillées. Il n’a pas voulu partager des confessions, voulant d’abord se référer aux adjoints au maire de la ville de Dakar.
I. SANE
 Dans l'univers de la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar
Dans l'univers de la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar
Il est de ces métiers où l’on côtoie en permanence la mort. C’est le cas des morgues. Malgré son passé de fantassin dont le cœur de métier est la guerre, donc préparé à faire face à la mort, les premiers jours du major Samba Cor Diop au service de la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar n’ont pas été faciles.
« Je suis militaire et fantassin de spécialité. Mon métier, c’est la guerre. Donc, je suis préparé à voir la mort », avertit-il. Mais, depuis que « je suis affecté à la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar, j’ai connu une autre vision de la mort. Le rapport à la mort dans l’infanterie est différent de la gestion de la morgue qui reçoit en permanence des cadavres de toutes sortes », fait-il remarquer. Pour son cas, reconnaît-il, les premiers jours de sa prise de service ont été pénibles ; les images des corps lui revenaient tout le temps, surtout une fois qu’il est chez lui. Mais, au bout de quelques temps, le major Diop a commencé à s’habituer et à ne plus avoir de visions.
Sur le registre des souvenirs les plus marquants, le chef du service de la sécurité interne de l’Hôpital Principal explique, sans donner plus de détails, qu’il y a eu des cas extrêmes de morts accidentelles et autres où les corps leur sont parvenus dans des conditions « difficilement tenables ». « Mais, mon équipe et moi avons fait notre travail. Pour chaque cas, nous avons pris les corps dans le plus grand respect qui leur est dû, aussi bien pour les musulmans que les chrétiens. Nous les préparons et faisons leur toilette avant de les présenter à leurs parents pour leur inhumation », confesse-t-il.
Le major Samba Cor Diop souligne qu’ils travaillent (lui et son équipe) dans un environnement bien organisé. « A leur arrivée, les corps sont d’abord reçus au service des urgences où l’on vérifie le certificat de décès avant qu’ils ne soient envoyés à la morgue. Une fois dans notre service, si le corps est identifié et les parents informés, nous nous conformons à la volonté de ces derniers. Si les parents souhaitent que nous nous occupons du lavage mortuaire, nos éléments le font conformément à la religion du disparu », assure-t-il. Pour lui, il est utile de noter qu’ils ont un service bien organisé qui observe scrupuleusement les règles de gestion des dépouilles mortelles. A coté du chef de service, la morgue de l’hôpital Principal dispose de trois éléments formés en lavage de corps à l’Institut islamique de Liberté 6. Le major est satisfait de ses collaborateurs qui, à ses yeux, sont « très compétents et s’acquittent à merveille de leur tâche ».
La morgue la mieux entretenue de Dakar
« Parler de la morgue sans la visiter ne vous permet pas de connaître notre métier. Donc, je vous invite à aller voir la réalité du terrain », nous lance le patron de la morgue de l’Hôpital Principal. Comme dans tous les hôpitaux, la morgue de cette structure sanitaire se trouve à l’arrière-cour, loin des regards des patients et autres visiteurs. Si la porte principale sert d’entrée et de sortie pour les visiteurs et malades, celle de la morgue ne sert que pour la sortie, une sortie vers la dernière demeure.
Située à 300m du bureau du chef de service, au bout d’une ruelle bordée de fleurs où règne le calme, la morgue jouxte une petite paroisse. Le bâtiment ne paye pas de mine. Le portail qui fend le mur de séparation avec le reste de l’hôpital donne sur la gauche sur un petit bureau. C’est le coté administratif de la morgue. En face, une courette mène aux locaux. Le major Diop nous montre les différentes pièces. Il explique que « la morgue dispose de deux salles de lavage et autant de salles d’exposition de corps. Nous avons aménagé les salles selon la confession à laquelle appartiennent les dépouilles mortelles. Pour l’accueil des parents, la morgue dispose d’une grande cour, ainsi que d’une une salle d’attente pour les autorités et autres personnalités ».
25 tiroirs
Après cette présentation de la vue d’ensemble, le major nous ouvre les portes des salles de lavage où trône, au centre, une paillasse carrelée bien propre. Le chef de la morgue, accompagné d’un de ses collaborateurs, Ibrahima Gning, se dirige vers une porte. C’est la salle de conservation des corps. Elle dispose de 25 tiroirs, dont une dizaine est réservée à la congélation. Le major nous signale qu’il arrive que des corps restent à la morgue plusieurs mois parce qu’ils sont non identifiés ou leurs parents ne sont pas joignables. Dans ces cas, ces corps sont gardés le temps de faire des investigations pour retrouver les proches. Si ces démarches n’aboutissent pas, son inhumation est ordonnée par l’autorité compétente.
Revenant sur la gestion de la morgue, le major Diop avance avec fierté que sa structure est la mieux entretenue de Dakar. En effet, la chambre froide est très propre. Lorsqu’on regarde les tiroirs, rien ne renvoie à leur contenu. Sur demande du major, Ibrahima Gning ouvre un premier tiroir où se trouve un corps couvert d’un tissu blanc. Le deuxième tiroir qu’il nous propose de voir contient une petite caisse. Il nous explique que ces caisses contiennent le corps des mort-nés.
Mbaye Sarr DIAKHATE
MATERNITES : Le berceau de tous les souvenirs
Dans les maternités, les mères et les sages-femmes poussent un ouf de soulagement après chaque naissance. Mais parfois, les sages-femmes vivent dans cet espace des souvenirs douloureux. Après chaque accouchement, ces professionnelles ressentent une satisfaction intérieure, un réconfort. C’est une autre forme de délivrance.
La maternité de Grand-Yoff s’incruste dans la flopée des habitats. Les femmes, leur nourrisson sur le dos ou dans leurs bras, arrivent à pied ou descendent des taxis. A l’intérieur, les couloirs de la zone de consultations ne désemplissent pas. Les uns après les autres, elles entrent dans le bureau du médecin. Ici, en cette matinée de décembre, les praticiens s’affairent à épuiser la liste des malades à temps. De l’autre côté, ce n’est pas la grande affluence. Le décor ne renseigne pas sur le taux de fréquentation.
De part et d’autre de la porte du bureau de la maîtresse des sages-femmes, des affiches portent les messages de prévention des maladies liées à la grossesse. Dans une autre salle, un groupe de matrones et de sages-femmes est sur le qui-vive. Après quelques minutes d’attente, la maîtresse des sages-femmes nous ouvre son bureau. Elle accepte de partager une partie de sa vie professionnelle. Derrière ses lunettes claires, elle garde de bons souvenirs. « Lorsque nous parvenons à sauver des vies, nous sommes très soulagées. Nous poussons un ouf de soulagement. Parce que ce sont nos efforts qui sont récompensés. Parfois, il nous arrive de faire plusieurs heures pour faire accoucher une femme », raconte Aïssatou Diallo.
Mais, ce ne sont pas uniquement les beaux souvenirs qu’elle a dans son livret professionnel. La praticienne parle d’autres faits avec moins d’enthousiasme. Mme Diallo, comme plusieurs autres sages-femmes ou matrones, a vécu, impuissante, la disparition de nourrissons. « Dès fois, nous vivons des moments difficiles. Il y a des décès lors des accouchements », confie-t-elle.
Ce vendredi de janvier, l’atmosphère est plate au centre de santé de Yarakh. La maternité ne fonctionne pas à feu continu. Deux praticiennes sont dans leur salle. Une sage-femme, apparemment la cadette de l’équipe, nous reçoit avec une certaine déférence. Ici, elles affichent la sérénité. A l’intérieur du pays, les jours de garde sont vraiment des jours de veille. « Les postes de santé ou les centres de santé ne sont pas dans des conditions de sécurité dans les régions. J’ai été victime d’une agression lorsque j’étais en poste à Tambacounda alors que j’étais jeune sage-femme », raconte Fatou Touré Thiam. Elle révèle qu’une autre praticienne en poste dans une région en crise du Sénégal a vécu des situations plus dramatiques. Cette dernière, regrette Mme Touré, a été dépouillée de ses appareils de luxe. Outre les agressions, elle estime que les couples avec une conjointe sage-femme sont moins stables. « Je n’ai pas un ratio scientifique. Mais les couples de sages-femmes sont moins stables. Du fait des gardes, la femme passe parfois la nuit dans les structures de santé », évoque la praticienne.
Elle remonte le fil de ses souvenirs. Là-bas dans son ancien poste, la sage-femme a eu à remplir plus que son cahier de charges. Elle a eu à donner à plusieurs reprises son sang pour sauver des vies. « En tant que sage-femme, nous sommes aussi des conseillères. Nous sommes entre la santé et le social. Nous avons la confiance des femmes. Elles nous parlent de ce qu’elles ont de plus intime. Nous échangeons de façon régulière et profonde. C’est un honneur pour nous. J’ai personnellement reçu beaucoup de cadeaux et j’ai eu aussi beaucoup d’homonymes à Tambacounda », confesse Fatou Touré Thiam.
Le métier de sage-femme, clame-t-elle avec une dose de fierté, est très noble. Les sages-femmes vivent une satisfaction intérieure lorsqu’elles aident une femme à accoucher. « Après chaque accouchement réussi, c’est une sorte de confirmation pour nous. C’est très réconfortant de sauver des vies. Cela nous glorifie. Il y a une certaine reconnaissance de la société que nous ressentons », laisse entendre Mme Thiam. Dans les couloirs des maternités, la déception peut survenir à des moments les plus inattendus. Il y a des jours inoubliables. « Nous essayons, en conformité avec notre éthique et avec déontologie, de faire correctement notre travail. Mais parfois, il arrive qu’il y ait des décès. Nous ressentons au fond de nous ces pertes en vie humaine », reconnaît la sage-femme. L’exercice de ce métier est très contraignant.
Aujourd’hui, du fait du déséquilibre entre les capacités d’accueil et la demande, l’image de ces spécialistes est un peu ternie. Elles méritent mieux.
I. SANE
Professeur Abdoul Kane, cardiologue a l’hopital de Grand Yoff : « Avec l’habitude, le médecin finit par s’habituer aux drames »
L’ouvrage du cardiologue Abdoul Kane, « La vie sur un fil », concentre les maux des hôpitaux. L’universitaire rapporte, entre autres, l’histoire d’une femme victime d’une maladie cardiovasculaire et dont l’enfant est confié à une famille. Celle-ci, avec l’hospitalisation qui perdurait, a choisi de se débarrasser de son nourrisson. Cette scène illustrant la perte des valeurs de solidarité a fait fondre en larmes une des infirmières du service de cardiologie. Et comme cela ne suffisait pas, cette dame a été séquestrée à l’hôpital après son hospitalisation. Au cours de cet entretien, l’universitaire tente d’expliquer la perte des valeurs humanistes avant d’affirmer que du fait de l’accoutumance, le praticien de la santé peut s’habituer à des drames.
Professeur Abdoul Kane, vous avez publié un livre sur les maux qui gangrènent les hôpitaux sénégalais. Peut-on avoir une idée des ventes de « La vie sur un fil » ?
Je suis assez surpris en suivant toutes les discussions que le livre a suscitées. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la presse et les populations. L’ouvrage a été particulièrement lu. Il y a même eu une deuxième édition. Parce que deux mois après la cérémonie de lancement, les librairies de Dakar n’en avaient plus. Le livre a été très bien vendu.
Vous avez parlé de la perte généralisée des valeurs humaines. Comment expliquez-vous ce fait dans nos hôpitaux ?
Dans le livre, j’ai fait beaucoup de rappels sur ce qu’est actuellement notre société. Si vous avez fait des études de médecine, il vous faut un Bac plus 8 ou Bac plus 13 ans en spécialisation. Lorsque vos parents vous voient circuler en car rapide ou en « Ndiaga Ndiaye », ils vous diront comment pouvez vous faire toutes ces études et vous retrouver dans ces conditions. Ils vous diront que telle ou telle personne a acheté un 4x4 ou bien a construit un immeuble. C’est la société elle-même qui nous pousse à aller vers ces errements. Elle considère que c’est le matériel qui prime désormais sur tout. C’est ce qui arrive aux médecins. Auparavant, les médecins étaient tellement convaincus de ce qu’ils faisaient. Ils avaient le minimum et s’en contentaient. Aujourd’hui, des étudiants en médecine commencent déjà à penser à s’enrichir, et ils le font même au détriment de leur propre formation. Et lorsque vous avez ce type de soignant, cela va faire très mal. L’autre élément important, c’est que nous avons reçu une éducation de base à la maison, dans une famille. Mais, de nos jours, nous avons perdu certaines de nos valeurs. Cette formation de base doit se poursuivre dans des écoles. Pour les professions soignantes, les infirmiers et les sages-femmes vont dans les écoles de formation et les médecins à la Faculté de médecine. Je pense que la première chose qu’on doit inculquer à ces futurs personnels soignants, c’est de leur dire qu’ils vont traiter des êtres humains. Donc, ils doivent avoir une capacité d’écoute. Nous devons avoir conscience qu’un soignant doit techniquement être bon mais aussi, il doit être un grand humaniste.
Pouvez-vous revenir sur l’affaire de cet enfant qui avait un problème de prise en charge et dont les parents devaient envoyer de l’argent en Europe afin qu’il puisse être traité ?
L’enfant, qui était gravement malade, se trouvait dans une structure de soin. Il avait une infection contractée dans cette structure sanitaire. Ce qui peut être assimilé à une erreur médicale. Quelques jours plus tard, il revient, et on lui dit qu’on ne pouvait pas le prendre en charge s’il n’a pas une caution. Ce n’est pas parce que les parents de l’enfant n’avaient pas les moyens, mais la prise en charge se prépare. Il a fallu toute la journée pour coordonner. La prise en charge devait se régler depuis l’étranger, parce que le père est un fonctionnaire international. Et c’est tard dans l’après-midi qu’on a reçu le fax qui garantit la prise en charge. Durant tout ce temps, l’enfant, qui souffrait d’une infection grave, était laissé à lui-même et aurait pu perdre la vie. C’est tout simplement pour illustrer ce qui peut se passer lorsqu’on est dans le mercantilisme. On met en balance la vie des êtres humains. C’est cette histoire qui a d’ailleurs donné le nom à mon livre.
Professeur, outre l’histoire de cet enfant, est-ce qu’il y a d’autres scènes qui vous ont marqué ?
Lorsque vous pratiquez la médecine, vous voyez chaque jour des choses heureuses mais aussi des drames. Dans une des nouvelles de mon ouvrage, j’ai parlé d’une dame que j’appelle la sainte-mère. Cette histoire m’a beaucoup marqué. Ceux qui ont lu le livre sont presque convaincus que c’est une histoire vraie. Et ils ont raison. J’ai effectivement vu une dame qui avait tellement la foi qu’elle a commencé ses prières au moment où nous réanimions son enfant qui était en réalité un adulte. C’est quand je faisais mon stage rural à Tambacounda. La dame n’a pas interrompu sa prière jusqu’à la fin. Après sa prière, la première chose qu’elle a faite, c’est de se diriger vers nous pour nous remercier et prier pour nous sans larmes. Ensuite, elle m’a demandé de pouvoir rester avec son fils pour lui procurer des prières. Par contre, d’autres choses m’ont choqué, comme l’histoire de la séquestration. C’est pourquoi j’en parle beaucoup. Et récemment, l’histoire d’une femme. En revenant d’un voyage, j’ai trouvé dans le couloir de mon service une de mes infirmières en sanglots. Je lui demande qu’est-ce-qui se passait ? Elle ne pouvait pas me le dire. Elle était traumatisée. Mais je me suis rendu compte que la dame qui était séquestrée avait accouché. Et l’accouchement peut décompenser une maladie du cœur. Elle habitait derrière Tivaouane. Mais, comme la plupart des structures de cardiologie sont concentrées à Dakar, elle était venue pour se faire soigner. Vu qu’elle était en réanimation, nous ne pouvions pas garder le bébé et nous l’avions confié à sa famille qui était à Dakar. Cependant, au bout d’une semaine, la famille est venue demander à ce qu’on libère la maman dont la santé n’était pas encore stable. Lorsqu’elle est devenue stable, nous l’avons libérée. Mais, on l’a encore séquestrée une semaine de plus. Les membres de sa famille à qui nous avions confié la garde du bébé sont venus devant l’hôpital et ont menacé de jeter le bébé, parce qu’ils ne pouvaient plus le prendre en charge. C’est l’image de ce bébé qui avait fait effondrer mon infirmière. Cette séquence m’a beaucoup marqué et résume en quelque sorte mon livre. Dans notre société, les personnes n’arrivent plus à maintenir les valeurs de solidarité.
Tout dépend des valeurs humaines que nous avons véhiculées. Que se passe-t-il aujourd’hui quand il y a un décès ? A l’enterrement, certains commencent à discuter du match de football. Les funérailles, c’est maintenant une vaste campagne de causerie. Je pense que la société s’est forgée une nouvelle approche qui n’est pas humaine. Ce médecin qui appartient à cette société va tout simplement se conformer à ce qui est érigé en normes. C’est vrai qu’un médecin qui a l’habitude de vivre des drames à l’hôpital finit par s’y habituer. Mais il est important que les personnes aient cette humanité au fond d’eux-mêmes.
Propos recueillis par I. SANE
source: http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=35469:personnel-de-santegardiens-de-morgue-et-de-cimetiere-quand-lhabitude-banalise-la-mort-&catid=78:a-la-une&Itemid=255