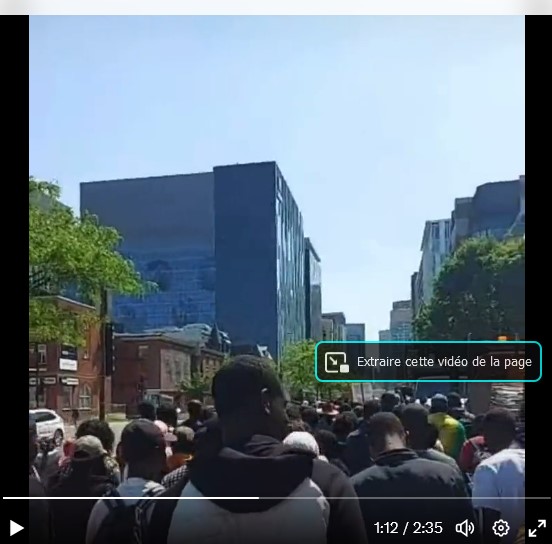Sur la carte, le Brésil impressionne par la grandeur de ses Etats. Par la beauté des noms aussi : le Goiás, le Mato Grosso et le Minas Gerais pour le centre ouest ; Bahia, le Pernambuco, le Paraíba, le Maranhão, le Ceara, l’Amapa, le Piauí, le Para pour le Nordeste et le Nordoueste. L’Amazonie, le Roraima, l’Acre pour l’ouest et encore, Sao Paulo, le Rio Grande Do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina pour l’est. Sublime et gigantesque, le Brésil est à lui seul, un continent où se retrouvent toutes la race humaine. : des noirs, des blancs, des peaux rouges, des jaunes, un métissage de tous horizons…
Toujours pour le décor, le pays de la Présidente Dilma Russel est aujourd’hui, le cinquième pays du monde par sa superficie (8,5 km 2), le Brésil est recouvert par le plus grand bassin forestier de la planète, l’Amazonie. Véritable poumon de l’Amérique latine, il est sillonné par une multitude de fleuves et de rivières révélant un incroyable trésor de biodiversité. Territoire d’aventure mais aussi de plages ensoleillées où il fait bon de faire son jogging et danser la samba le soir au soleil couchant, le Brésil saura combler vos espérances en vous offrant le visage que vous souhaitez lui donner…
Un Mundial brésilien de toutes les incertitudes. Le titre n’est pas flatteur pour le pays de Pelé, mais c’est le monde en lui-même qui a changé depuis que l’annonce de la belle fête du football a été faite il y a cinq ans. Les nostalgiques de la finale de 1950, encore vivant et en jambes, y verseront nul doute des larmes au moment de la cérémonie d’ouverture, mais on sera bien au Brésil et à Sao Paulo.
Le Mundial de football est toujours un grand évènement. Le Brésil en 1950 sur fond de dictature militaire. L’argentine en 1978 sous les baïonnettes de l’armée et les nombreux disparus. Le Mexique en 1986 avec la corruption, la drogue et les narcotrafiquants. Le Brésil en 2014, 64 ans après la première de 1950, encore sur fond de corruption, de violence urbaine et enfin de démocratie. Ça peut être le scénario d’un grand film, mais, entre l’Amérique du Sud et la World Cup, la fête a été toujours été faite avec quelques questions sans réponses jusqu’au dernier moment.
Juin 1978, lorsque l’Argentine accueille la Coupe du monde. Et, le monde n’a d’yeux que pour sa dictature, son président-général, Jorge Rafael Videla, militaire dur, à la solde d’une junte qui a été à la base de nombreux assassinats d’intellectuels communistes et défenseurs de la liberté. Aux côtés de l’entraineur Luis César Menotti, les noms de René Houseman l’ailier artiste, Osvaldo Ardiles, Jorge Mario Olguin, Omar Ruben Larrosa, Luis Galvan, Leopoldo Luque, Mario Kempes entrent dans l’histoire avec une coupe du monde qui démarre autour de tensions politiques qui vont l’emporter sur le reste. La victoire des partenaires du belliqueux capitaine Daniel Passarella, n’en fut que plus anecdotique.
Sous la dictature de Videla, les militaires argentins répriment brutalement l'opposition de gauche, lors de la prétendue « guerre sale », qui n'eut de guerre que le nom : les guérillas comme l'Armée révolutionnaire du peuple (Erp) et les Montoneros étaient déjà démantelées en mars 1976. Ces mêmes militaires ne sont pas privés également de s’attaquer aux opposants civils : politiques, syndicalistes, prêtres et nonnes parmi lesquels, on peut citer Alice Domon et Léonie Duquet, Gabriel Longueville etc., de même que les Mères de la place de mai ainsi qu'à leurs familles, leurs enfants, leurs amis, leurs voisins.
Cette entreprise aujourd'hui qualifiée par la justice argentine de «génocide» (voir par exemple la condamnation, en 2008, du général Antonio Domingo Bussi), fut justifiée par la junte au nom d'un anti-communisme virulent, lié à un national-catholicisme prétendant défendre la grandeur de la « civilisation catholique occidentale » contre les « rouges » et les « juifs ». 30 000 personnes furent victimes de disparitions forcées sous la dictature, 500 centres clandestins de détention et de torture créés, tandis qu'environ 500 000 personnes furent contraintes à l'exil, qui plus est, clandestin dans les premières années de la junte, qui refusait alors de délivrer des visas de sortie.
Au cœur de la dictature, c'est lui qui remet la Coupe du monde de football 1978 au capitaine de l'équipe argentine, Daniel Passarella, « El Pistolero ». Cette coupe du monde s'est déroulée au moment même où les tortures et assassinats s'exécutaient dans les sous-sols de l'École supérieure de mécanique de la Marine (Esma), à proximité des stades de Buenos Aires où se jouaient les matches dans la liesse populaire.
Un pays d’immigration fou de sport
En cette année 2014, lorsque démarre le compte à rebours pour le mondial brésilien, l’on est loin de penser que le peuple carioca et des autres contrées du pays de Pelé, fier, de brandir ses cinq trophées, ne veut plus de cet évènement. Si la Fifa s’en réjouit, le Brésilien moyen qui vit d’expédiant, est un homme énervé et déçus par les milliards de reals investis pour construire une douzaine de stades nouveaux, dans un pays où personne ou presque ne regarde plus le championnat moribond qu’on leur offre les équipes comme Fluminense, Vasco de Gama, Botafogo, Corinthians ou le Gremio. Un cycle s’achèvera sûrement dans ce pays et au lendemain du Mundial, le 13 juillet ; un autre devrait commencer pour l’immense Brésil ; plus dur, plus incertain au seul profit de la réal-économie.
Le vrai football est mort. Vive le football business avec son monde en mal de stars créées de toutes pièces au nom de l’argent et non du talent. Au moment où le Brésil qui a déjà commencé à vivre les contrecoups de cette 20ème édition du Mundial avec ces travers, avec ces menaces de révolte au plan social, l’on est face à d’énormes interrogations qui risquent de réduire le succès de l’évènement. Placé sous le signe du foot-business, le Mundial brésilien avait tout pour être une belle fête, derrière les larmes d’émotion du président Lula Da Silva quand son pays a été désigné.
Aujourd’hui, comme en 1950, l’on craint pour des raisons totalement opposées, les effets d’une grande catastrophe nationale et peut-être mondiale au moment où le pays est plongé dans une profonde crise sociale. Au nom de l’argent et d’une coupe, l’on a fini de tuer le jeu au seul profit des exigences de la Fifa. D’ailleurs, grosse absurdité, depuis la victoire du Brésil en 1970 et l’appropriation de la Coupe du nom de Jules-Rimet, le nouveau trophée gagné par l’Allemagne en 1974, n’a pas de nom.
Que veut dire d’ailleurs ce nom de Coupe du Monde de la Fifa ? Pelé, Nelson Mandela, Di Stefano, Allende, Jules Verne, les héros ne manquent pas pour hériter de ces noms qui incarnent une histoire et des faits de civilisation.
Le jeudi 12 juin, le monde aura les yeux rivés sur un pays, sa culture, ses héros et son histoire. Jusqu’à la finale le 13 juillet 2014, le Brésil ne se présentera pas seulement comme l’organisateur de cette 20ème édition de la Coupe du monde, mais comme le miroir d’un univers où le football est devenu le sport le plus suivi de la planète. Contraste d’une discipline qui a perdu ses artistes, les droits de télé explosent au moment où les stades ne comptent plus de grands artistes comme Garrincha, Didi, Cubillas, Beckenbauer, Netzer, Pelé, Carlos Alberto, Jairzinho, Cruyff, Rep, Falcao, Maradona, etc. Trop d’images pour un sport en mal de génie.
Autre absurdité des temps modernes, les spécialistes du jeu en perdent leur latin. Et, au-delà de l’esprit du sport, certains ne s’y retrouvent plus. Comme un pays d’Afrique sans moyen, le Brésil a aujourd’hui l’un des championnats les plus faibles d’Amérique. Le football dit moderne est un sport de mercenaires où les meilleurs ne sont pas sélectionnés, mais les plus riches et les plus chers chez les joueurs. L’exemple est donné avec ce Brésil, version européenne dont une bonne partie de l’équipe face à la nouvelle division du travail, vient d’Europe.
1962 et 1970 sont loin. Très loin avec tous, ces joueurs d’un championnat méconnu que le monde découvrait avait pour nom : Gilmar, Amarildo Tavares da Silveira, grande star des années 1960 qui a joué au Milan AC, à la Fiorentina, l’As Rome avant de retourner finir sa carrière en 1974 du coté de Flamengo.
Il y a aussi d’autres grands comme Mané Garrincha, Mario Zagalo, Pelé, Rivelino, Paulo César... Et, les talents d’une équipe venue d’ailleurs sur les aires de jeu mexicaine, sont passés par là. Mais, que ce fut beau, le carnaval déplacé dans ce pays pour une coupe du monde qui a été jusqu’ici la meilleure sur le terrain au plan du jeu. Mexico 70. Un slogan. Une époque dorée pour le Brésil. Mais, le temps est aussi passé. Les pays ont changé ; et avec eux, le football et ses composantes. A cause de le vente effrénée des meilleurs talents comme de footballeurs très jeunes offerts à de « nouveaux négriers » qu’on épuise avant leur 20 ans, les championnats hors d’Europe, à commencer par le pays de Pelé, se sont affaiblis.
Le Brésil devenu un anti-modèle. Voilà qu’au fil des ans, l’adage est devenu presqu’indéfendable, parce que le pays n’a rien gagné d’autres que ces coupes du monde. Entre les joueurs qui partent à tous les coups, se greffent les tares d’une société très malade ballottée entre la corruption, la gouvernance dans l’à peu près, les magouilles et… la prostitution. On pensait que le pays a changé. Oui, le Brésil a changé parce qu’il y a une jeunesse qui a pris conscience, grâce au président Luiz Inácio Lula Da Silva et la démocratie, de son avenir qu’on hypothèque à chaque génération.
Une radio et une presse privée plus privée ont aidé dans cette prise de conscience. De jeunes reporters sillonnent d’ailleurs les grandes villes comme Rio, Sao Paulo, pour lire et dire la misère des gens. Les scandales autour des retards subis dans le déroulement des travaux de reconstruction, n’auraient pas été dévoilés sans la présence de cette presse. Avant même le démarrage de la compétition, les problèmes liés à la finition des travaux du stade de Sao Paulo qui devrait recevoir le match d’ouverture, sont un signe.
Là, se trouvent les raisins de la colère qui gronde dans le pays de Dilma Russel ; même nanti de cinq victoires en coupe du monde. Que vaut aujourd’hui, un sixième succès pour la population de Rio, du Minas Gerais, du Mato grosso, de Belém, Manaus, en Amazonie, dans le Nordeste pauvre et presque résigné et dans le sud plus bourgeois vers Porto Alegre. Longtemps endormi par les victoires, le brésilien voyait dans son carnaval et le football, un moyen de signifier quelque chose dans le gratin mondial. Le monde a changé d’exigences.
Aujourd’hui, les joueurs comme des « machins » sont l’objet d’échanges et de marchandage ; et dans le lot, les meilleurs ne brillent pas toujours. Mais, ça c’est pour le football et seulement pour le sport. Et, il y a autre chose dans ce Mundial.
Cinq coupes et toujours la misère
Avant hier Garrincha et Djalma Santos, avant-hier, Ronaldo, Ronaldinho, Kafu, aujourd’hui Robinho, Kaka, mais surtout Neymar, Oscar ou Thiago Sylva… Combien sont-ils les enfants des favelas enrichis par le football ou lâchés par le système d’éducation. Certains parmi eux n’avaient que le football et sont aujourd’hui, des inconnus en errance autour des cafés de rio, de Sao Paulo, de Recife à raconter à ceux qui ne veulent plus les écouter, leur histoire. C’est aussi ça le football au Brésil. Pour un pays qui a besoin de ses enfants à tous niveaux, que veut dire gagner une Coupe du monde aujourd’hui ?
Qui se rappelle encore de Luis Pereira, défenseur central de l’équipe de 1974 ? Au chauffeur de taxi pris à Rio à qui la question j’avais posé la question, la réponse a sonné très simple. « Il est là ». Autre exemple Garrincha, génie du ballon rond, mort très pauvre, malade et abandonné. On se rappelle peu de Serginho, avant centre de l’époque de Claudio Coutinho en juin 1978 en Argentine, qui s’en souvient même au Brésil ? Et encore, de Valdir Peres, de Paulo Isidoro, excellent manieur de ballon, de Toninho Cerezo, ancien de l’Atletico Mineiro et de la Sampdoria de Gênes. Tous n’ont pas eu la chance d’un Socrates, diplômé de médecine et footballeur. Tous n’ont pas eu aussi la chance d’un Ronaldinho qui force la folie jusqu’à se payer une île aux larges de Rio de Janeiro.
Terrible insolence dans un pays riche où la misère n’est jamais loin. Jusqu’au début des années 2000, l’essentiel des enfants qui ont dépassé à peine trois années d’études, vivait dans les villes de l’est sur un triangle Brasilia, Porto Alegre, Recife. Le Brésil compte plus de 54% d’analphabètes dans certaines zones dans le Nordeste et en Amazonie par exemple. Et dans le lot, l’analphabétisme des femmes est en général supérieur à celui des hommes. Dans cet énorme territoire, une bonne partie des populations, si elle est allée à l’école, ne dépasse pas régulièrement 1,44 année d’étude.
Le Brésil est un pays infernal disait un professeur de géographie et Rio est son enfer. Cette coupe du monde sera l’occasion de le conforter dans sa vision ou de l’infirmer. Mais, il semble que les clignotants, quoi qu’il arrive, ne seront pas tous verts. La peur de la déception de 1950 est toujours dans l’esprit des plus vieux ; les jeunes, eux, s’en moquent. Ils n’ont pas connu cette histoire et sont au chômage depuis longtemps pour certains. Une sixième victoire, et le lendemain, retour à la galère ; qu’est-ce que cela change, se demandent la plupart ?
Au fil des ans, la Fédération internationale de football association, même dirigée par un Brésilien du nom de Joao Havelange n’a pas permis au pays d’asseoir convenablement au milieu des années 1990, sa place de 9ème puissance mondiale. Et pire, sa belle sixième place pour l’économie mondiale et au sein du groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et du G20 ne lui a pas, non plus, permis de faire ce qu’on qualifie de grand bond en avant au plan social. Là se trouvent les sources du malaise brésilien.
A suivre
SOURCE:http://www.sudonline.sn/le-mundial-bresilien-cote-pile-et-face_a_19346.html